Présentation

Le management a été très longtemps marqué par des approches comportementales. Celles - ci prétendent délivrer des modes d'emploi qu'il n'y aurait à appliquer pour obtenir la performance souhaitée. Mais cette vision a ses limites. Elle ne prend pas en compte la dimension du sujet. La psychanalyse ne délivre pas de recette mais ouvre à une anthropologie, c'est à dire à une compréhension en profondeur des motivations humaines. Les managers ont aujourd'hui besoin de changer de niveau et sortir d'une relation caractérisée par la domination archaîque ou la manipulation cynique. A travers 5 lecons, l'auteur Georges Trepo, professeur honoraire à HEC, nous propose d'explorer les forces profondes qui caractérise l'énergie psychique humaine qui constitue une part importante de l'activité des managers trop longtemps séquestrés dans une approche calculatrice de la performance.
Si le thème est innovant sur le fond, il le sera également sur la forme. Chaque leçon comprendra :
- Un article de 3 ou 4 paragraphes rédigé par Georges Trepo
- Une discussion des concepts présentés et leur implication pour les managers en action. Ces discussions seront animés par d'autres enseignants chercheurs en Management. Les lecteurs seront invités évidemment à participer à ces échanges.
- Une série de webconférences sur inscription animées par Georges Trepo
- Des ateliers à distance d'échange des pratiques animées par des animateurs formés aux méthodes d'analyse des pratiques de type "Groupe Balint"
Thèmes des 5 leçons
Leçon 1: L’inconscient
Leçon 2: La structure de la personnalité
Leçon 3: Le rôle de l’angoisse et les mécanismes de défense
Leçon 4: Le caractère en tant que défense et les stades de développement de la personnalité
Leçon 5: Personnalité et Leadership
Si le thème est innovant sur le fond, il le sera également sur la forme. Chaque leçon comprendra :
- Un article de 3 ou 4 paragraphes rédigé par Georges Trepo
- Une discussion des concepts présentés et leur implication pour les managers en action. Ces discussions seront animés par d'autres enseignants chercheurs en Management. Les lecteurs seront invités évidemment à participer à ces échanges.
- Une série de webconférences sur inscription animées par Georges Trepo
- Des ateliers à distance d'échange des pratiques animées par des animateurs formés aux méthodes d'analyse des pratiques de type "Groupe Balint"
Thèmes des 5 leçons
Leçon 1: L’inconscient
Leçon 2: La structure de la personnalité
Leçon 3: Le rôle de l’angoisse et les mécanismes de défense
Leçon 4: Le caractère en tant que défense et les stades de développement de la personnalité
Leçon 5: Personnalité et Leadership
Les deux forces fondamentales qui motivent l'homme : le désir et l'agressivité
La psychologie psychanalytique a servi traditionnellement à la compréhension clinique de l'individu et de son développement, mais l'ensemble de ses concepts peut - être utilisé dans un contexte plus large afin d'étudier le comportement de groupes et le monde du travail. Pour être en mesure de faire ce saut du contexte individuel au contexte social de façon à comprendre les motifs des comportements humains dans les organisations, il est important de se familiariser avec certains concepts fondamentaux utilisés dans la théorie psychanalytique.
On y postule que deux forces principales motivent l'homme: l'une étant libidinale (elle a trait au sentiment d'amour) et l'autre l'agressivité.
Lorsqu'on passe en revue certains concepts fondamentaux de la théorie psychanalytique, on note deux postulats de travail importants. Le premier, le déterminisme psychologique suppose que, en ce qui concerne l'appareil psychique, rien n'arrive par hasard; que tout incident peut s'expliquer de façon logique; que la plupart des événements ont une signification. Ce qui peut sembler "irrationnel" à un observateur extérieur, devient "rationnel" du point de vue intrapsychique.
Le second postulat est tres étroitement lié au premier et traite de la motivation inconsciente. On peut supposer, à partir de l'observation clinique, qu'il y a dans l'individu, sous la surface consciente, émotions, désirs, besoins et fantasmes,; le fait de rendre compte de leur existence est extrêment important pour la compréhension du comportement humain.
L'analyse des mythes, des contes de fées et des rêves permet de mieux comprendre ce désir. Selon Freud le rêve est est "la voie royale vers l'inconscient"; l'imagerie du rêve offrant la possibilité de percer la dynamique des désirs intrapsychiques prédominants.
On y postule que deux forces principales motivent l'homme: l'une étant libidinale (elle a trait au sentiment d'amour) et l'autre l'agressivité.
Lorsqu'on passe en revue certains concepts fondamentaux de la théorie psychanalytique, on note deux postulats de travail importants. Le premier, le déterminisme psychologique suppose que, en ce qui concerne l'appareil psychique, rien n'arrive par hasard; que tout incident peut s'expliquer de façon logique; que la plupart des événements ont une signification. Ce qui peut sembler "irrationnel" à un observateur extérieur, devient "rationnel" du point de vue intrapsychique.
Le second postulat est tres étroitement lié au premier et traite de la motivation inconsciente. On peut supposer, à partir de l'observation clinique, qu'il y a dans l'individu, sous la surface consciente, émotions, désirs, besoins et fantasmes,; le fait de rendre compte de leur existence est extrêment important pour la compréhension du comportement humain.
L'analyse des mythes, des contes de fées et des rêves permet de mieux comprendre ce désir. Selon Freud le rêve est est "la voie royale vers l'inconscient"; l'imagerie du rêve offrant la possibilité de percer la dynamique des désirs intrapsychiques prédominants.
Les comportements sont l'expression des représentations imaginaires
Il est également important d'avoir à l'esprit ces 2 postulats du déterminisme psychologique et de la motivation inconsciente pour comprendre les processus organisationnels. Prenons par le exemple le cas du dirigeant très ambitieux qui, à la suite d'une promotion devient anxieux et incapable de prendre des décisions. Cette situation s'explique difficilement si on l'examine d'un point de vue "rationnel". On pourrait dire, de manière simpliste, que ce dirigeant a été promu à son niveau d'incompétence. Une analyse plus poussée, cependant peut révéler l'existence d'autres facteurs. On pourrait découvrir que le dirigeant a toujours été habité par un sentiment de colère intense à l'égard des figures d'autorité, un vestige de ses relations passées. le fait de remplir la fonction de son ancien patron peut avoir crée un conflit intrapsychique (sentiment de culpabilité).
Les fantasmes antérieurs de renverser l'autorité sont devenus réalité, causant de l'anxiété quant à d'éventuelles représailles. Qui plus est, on pourrait découvrir que l'agressivité, qui trouvait d'abord un débouché socialement acceptable dans des comportements compétitifs au sein de l'organisation, à l'égard des clients et des collègues, s'est retournée contre l'individu, un peu comme s'il méritait une punition pour avoir nourri ces désirs embarassants, hostiles. Il en résulte de l'angoisse et de la culpabilité. ce "récit" psychodynamique simplifié illustre jusqu'à un certain point comment l'apogée du succès peut déclencher le doute quant à sa propre valeur et causer de l'anxiété. Ce peut - être aussi le syndrome de l'imposteur.
Les fantasmes antérieurs de renverser l'autorité sont devenus réalité, causant de l'anxiété quant à d'éventuelles représailles. Qui plus est, on pourrait découvrir que l'agressivité, qui trouvait d'abord un débouché socialement acceptable dans des comportements compétitifs au sein de l'organisation, à l'égard des clients et des collègues, s'est retournée contre l'individu, un peu comme s'il méritait une punition pour avoir nourri ces désirs embarassants, hostiles. Il en résulte de l'angoisse et de la culpabilité. ce "récit" psychodynamique simplifié illustre jusqu'à un certain point comment l'apogée du succès peut déclencher le doute quant à sa propre valeur et causer de l'anxiété. Ce peut - être aussi le syndrome de l'imposteur.
La sublimation source de la performance au travail

Les deux forces fondamentales qui motivent l'être humain - la libido et l'agressivité - deviennent, à travers la transformation des expériences perceptuelles, fixées à des représentations mentales qui produisent des images , des symboles et des signes. Les deux forces fondamentales qui motivent l'etre humain la libido et l'agressivité deviennent à travers les expériences des représentations mentales donnant du sens à une réalité qu'elles créent (comme le dit Pirandello chacun sa vérité).
Bien que les pulsions libidinales et agressives soient présentées comme distinctes, un équilibre qui rend l'individu capable de fonctionner d'une manière acceptable pour la société. La faculté d'adaptation, la capacité d'aimer et de travailler présuppose cet équilibre des deux pulsions dans une forme plus neutralisée, sublimée. On retrouve ces deux pulsions, (sexualité et agressivité) - chez tous les mammifères. Les pulsions
(libido et agressivité) sont le combustible des actions humaines. Freud avait l'habitude de comparer le psychisme à un iceberg. La partie visible représente la conscience, tandis que la plus grande partie, invisible, symbolise l'inconscient.
Bien que les pulsions libidinales et agressives soient présentées comme distinctes, un équilibre qui rend l'individu capable de fonctionner d'une manière acceptable pour la société. La faculté d'adaptation, la capacité d'aimer et de travailler présuppose cet équilibre des deux pulsions dans une forme plus neutralisée, sublimée. On retrouve ces deux pulsions, (sexualité et agressivité) - chez tous les mammifères. Les pulsions
(libido et agressivité) sont le combustible des actions humaines. Freud avait l'habitude de comparer le psychisme à un iceberg. La partie visible représente la conscience, tandis que la plus grande partie, invisible, symbolise l'inconscient.
Application en clinique du travail
L'exemple suivant rédigé sous forme de cas pédagogique, par Yves Enregle est très illustratif des déterminismes inconscients et de la façon dont le passé influence le présent. Mr Gerbot est le dirigeant d'un cabinet de conseil qu'il a crée il y a quinze ans. Lors du recrutement d'un nouveau consultant, il s'oppose durement à ses propres collaborateurs qui ne voulaient pas du tout recruter Monsieur Paubert. Il décide malgré tout de son embauche et le fait travailler sur ses chantiers. La relation entre gerbot er son plus proche collaborateur défavorable à cette embauche se détériore. Ce dernier finit par quitter le cabinet en déclarant : "Je ne sais pas ce qui est arrivé au patron, il est devenu butté et cassant !".
Au bout d'un an et demi, Gerbot doit se rendre à l'évidence que Paubert n'a pas le contact client requis et il lui propose de travailler sur des travaux de documentation et de recherche. Il confiera à Yves Enregle: "Paubert me rappelait mon propre cas. Personne ne me donnait sa chance. J'ai voulu lui donner la sienne. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte de mon aveuglement".
Au bout d'un an et demi, Gerbot doit se rendre à l'évidence que Paubert n'a pas le contact client requis et il lui propose de travailler sur des travaux de documentation et de recherche. Il confiera à Yves Enregle: "Paubert me rappelait mon propre cas. Personne ne me donnait sa chance. J'ai voulu lui donner la sienne. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte de mon aveuglement".
Présentation de l'auteur
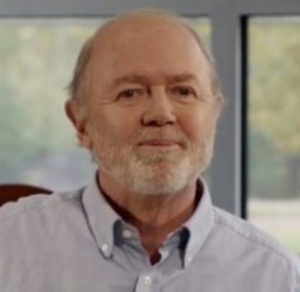
Georges Trépo est Professeur aux HEC, au Département Management et Ressources Humaines. Diplômé d'HEC, titulaire d'un MBA en finance de l'université de Chicago et d'un DBA de contrôle de gestion et de psychosociologie de la Harvard Business School, Georges Trepo étudie l'évolution des hommes et des structures ainsi que le développement des organisations et des ressources humaines.
Très actif dans ses domaines de prédilection que sont le management et les ressources humaines, il réalise de nombreuses publications et recherches. Georges Trepo a aussi co-écrit de nombreux ouvrages.
Preuve de son expertise, il a été membre du Conseil d'Administration, secrétaire général puis Président de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH) entre 1994 et 1998. Il a été responsable de la division "Management Consulting" de l'Académie of management (USA) de 2003 à 2006. Il est aujourd'hui Membre du Comité Editorial de Sciences de Gestion, de la Revue de Gestion des Ressources Humaines et de la Revue Française de Gestion. George Trepo consacre aussi son talent et son expérience à l'organisation de manifestations. Il a entre autre été animateur au prix Manpower de la meilleure thèse de GRH.
En savoir plus sur Georges Trepo
Très actif dans ses domaines de prédilection que sont le management et les ressources humaines, il réalise de nombreuses publications et recherches. Georges Trepo a aussi co-écrit de nombreux ouvrages.
Preuve de son expertise, il a été membre du Conseil d'Administration, secrétaire général puis Président de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH) entre 1994 et 1998. Il a été responsable de la division "Management Consulting" de l'Académie of management (USA) de 2003 à 2006. Il est aujourd'hui Membre du Comité Editorial de Sciences de Gestion, de la Revue de Gestion des Ressources Humaines et de la Revue Française de Gestion. George Trepo consacre aussi son talent et son expérience à l'organisation de manifestations. Il a entre autre été animateur au prix Manpower de la meilleure thèse de GRH.
En savoir plus sur Georges Trepo
Sigmond Freud : L'invention de la psychanalyse (Les commencements I)
Le premier documentaire de référence sur l'histoire de la psychanalyse : à partir d'archives encore peu exploitées, il raconte la destinée d'un homme exceptionnel et la naissance de cette nouvelle science, à Vienne, à la fin du XIXe siècle et ses développements au XX ème siècle. Les commencements (1885-1914) . Cette première partie présente trois moments essentiels de l'invention de la psychanalyse : le traitement de l'hystérie féminine à la fin du XIXe siècle ; la création à Vienne, autour de Freud, d'un premier cercle de disciples qui veulent comprendre la subjectivité humaine et la libérer de ses entraves en explorant les profondeurs du rêve, de la sexualité et de l'inconscient ; enfin, la fondation d'un mouvement international ayant pour objectif de diffuser à travers le monde la nouvelle doctrine, la nouvelle technique de guérison des maladies psychiques. Au centre du récit, on découvre d'abord l'histoire des médecins qui permirent à Freud de faire ses découvertes (Josef Breuer ou Wilhelm Fliess, par exemple), puis celle des femmes hystériques (Anna O. en particulier).
Homme de science et aventurier, Freud s'inspire de Darwin et se compare à Christophe Colomb. C'est alors qu'il s'entoure d'un premier cercle de compagnons, juifs et viennois pour la plupart (les "hommes du mercredi", hantés comme lui par l'idée de la mort et du déclin de la société dans laquelle ils vivent : l'empire des Habsbourg. Viennent ensuite les disciples non viennois, fidèles et infidèles, parmi lesquels Sandor Ferenczi (Budapest), Karl Abraham (Berlin), Ernest Jones (Londres), Carl Gustav Jung (Zurich)..
Homme de science et aventurier, Freud s'inspire de Darwin et se compare à Christophe Colomb. C'est alors qu'il s'entoure d'un premier cercle de compagnons, juifs et viennois pour la plupart (les "hommes du mercredi", hantés comme lui par l'idée de la mort et du déclin de la société dans laquelle ils vivent : l'empire des Habsbourg. Viennent ensuite les disciples non viennois, fidèles et infidèles, parmi lesquels Sandor Ferenczi (Budapest), Karl Abraham (Berlin), Ernest Jones (Londres), Carl Gustav Jung (Zurich)..
Sigmund Freud: L'invention de la psychanalyse (La conquête II)
Le premier documentaire de référence sur l'histoire de la psychanalyse : à partir d'archives encore peu exploitées, il raconte la destinée d'un homme exceptionnel et la naissance de cette nouvelle science, à Vienne, à la fin du XIXe siècle et ses développements au XX ème siècle. La conquête (1914-1960). Cette deuxième partie raconte les transformations de la psychanalyse après la Première Guerre mondiale et la défaite des empires centraux : son expansion hors de Vienne, sa conquête des grands pays démocratiques, puis l'exil vers les États-Unis et la Grande-Bretagne de tous les praticiens de l'Europe continentale, chassés par le nazisme et le fascisme. La situation particulière de la France est abordée à travers le rôle pionnier de Marie Bonaparte et des surréalistes.
On assiste en Allemagne à la destruction de la psychanalyse : les livres de Freud sont brûlés et sa doctrine condamnée comme "science juive". Soutenus par Jones, quelques praticiens médiocres acceptent de collaborer avec le régime nazi au nom d'un prétendu "sauvetage" de la psychanalyse. Au coeur du récit, on découvre la vie de Freud, son travail, ses livres, ses souffrances dues à la maladie, le développement de ses concepts et enfin ses relations avec sa famille, et notamment avec sa fille Anna, qui deviendra un chef d'école après avoir été analysée par lui. Les derniers moments de sa vie et son exil à Londres apparaissent dans des images en couleur d'une rare beauté. Autant la première génération freudienne était restée proche des théories du maître, malgré de violents conflits, autant la deuxième génération, formée à Berlin, s'éloignera de la doctrine initiale. C'est le cas notamment de Melanie Klein, rivale d'Anna Freud et principale représentante, dès 1925, de l'école anglaise de psychanalyse. Véritable fondatrice de la psychanalyse des enfants, elle oriente toute la clinique freudienne vers l'étude des origines de la psychose et des relations du nourrisson à la mère.
La dernière partie du documentaire évoque le devenir de la psychanalyse après la mort de Freud : les doutes, les illusions, l'impact des traitements pharmacologiques, ainsi que l'élan nouveau donné au freudisme par ceux qui n'ont pas connu le père fondateur (Jacques Lacan ou Donald Woods Winnicott).
On assiste en Allemagne à la destruction de la psychanalyse : les livres de Freud sont brûlés et sa doctrine condamnée comme "science juive". Soutenus par Jones, quelques praticiens médiocres acceptent de collaborer avec le régime nazi au nom d'un prétendu "sauvetage" de la psychanalyse. Au coeur du récit, on découvre la vie de Freud, son travail, ses livres, ses souffrances dues à la maladie, le développement de ses concepts et enfin ses relations avec sa famille, et notamment avec sa fille Anna, qui deviendra un chef d'école après avoir été analysée par lui. Les derniers moments de sa vie et son exil à Londres apparaissent dans des images en couleur d'une rare beauté. Autant la première génération freudienne était restée proche des théories du maître, malgré de violents conflits, autant la deuxième génération, formée à Berlin, s'éloignera de la doctrine initiale. C'est le cas notamment de Melanie Klein, rivale d'Anna Freud et principale représentante, dès 1925, de l'école anglaise de psychanalyse. Véritable fondatrice de la psychanalyse des enfants, elle oriente toute la clinique freudienne vers l'étude des origines de la psychose et des relations du nourrisson à la mère.
La dernière partie du documentaire évoque le devenir de la psychanalyse après la mort de Freud : les doutes, les illusions, l'impact des traitements pharmacologiques, ainsi que l'élan nouveau donné au freudisme par ceux qui n'ont pas connu le père fondateur (Jacques Lacan ou Donald Woods Winnicott).


 Visiteurs depuis Avril 2012 PARIS-Tech
Visiteurs depuis Avril 2012 PARIS-Tech



 2.32 La psychanalyse expliquée concrètement aux managers (Leçon 1: L'inconscient)
2.32 La psychanalyse expliquée concrètement aux managers (Leçon 1: L'inconscient)

